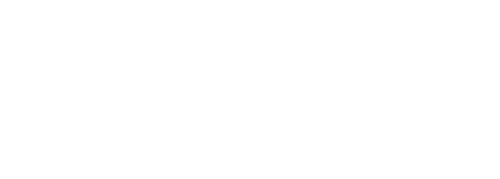Concrètement, ça veut dire quoi s’adapter ?
Exploitations
Généralités
À bien des égards, il est difficile de mesurer les effets du changement climatique sur chaque secteur de production. L’eau est un facteur essentiel : elle est indispensable pour les grandes cultures et les cultures fourragères, les animaux, mais aussi pour les humains. Il est donc important d'avoir une vue d'ensemble des besoins et de la consommation de son exploitation. On peut comparer l'eau à l'argent : si l’on ne l’économise pas, elle s'écoule tout simplement.
Deux autres points concernent l’ensemble de l’exploitation:
Pour répartir les risques, il est judicieux de se diversifier. À l’échelle de l’exploitation, il peut s’agir de produire dans différentes branches ou toucher plusieurs sources de revenu. À l’échelle d’une branche de production, il peut s’agir de diversifier ses espèces végétales ou animales. Les systèmes diversifiés sont plus résilients, les périodes incertaines peuvent donc mieux être gérées.
En outre, les effets du changement climatique peuvent varier considérablement d'une région à l'autre, en particulier dans un pays aussi petit que la Suisse. Il est donc très important d'analyser l'influence du changement sur sa propre exploitation.
Diversification
La diversification renforce la stabilité des systèmes. Si une branche de production (p. ex. les grandes cultures) fonctionne moins bien, notamment en raison de la sécheresse et de la chaleur, il est possible de compenser avec d'autres. Les exploitations suisses traditionnelles pratiquent déjà conjointement les grandes cultures et l'élevage. Néanmoins, ces deux branches sont toutes deux fortement touchées par le changement climatique. Il faut donc réfléchir à des extensions possibles qui sont moins dépendantes de l'environnement. En voici quelques exemples : l’agritourisme, l’accueil de personnes (en situation de handicap, par ex.), L’école à la ferme, la transformation à la ferme et vente directe, les offres de vacances (dormir sur la paille, trekking avec des lamas), les installations d'autocueillette, , la restauration, les travaux communautaires, la production d'énergie (photovoltaïque, bois, biogaz) etc. Ces développements doivent parfois s’accompagner d’une nouvelle manière de penser, mais pratiquer l'agriculture a toujours signifié s'adapter aux conditions.
Comme toutes les cultures et toutes les variétés, ni même toutes les espèces et races animales ne réagissent pas de la même manière à l'évolution des conditions, il vaut la peine de se diversifier là aussi. Comme il faut dans ce cas également trouver des nouveaux canaux de vente, il convient de réfléchir à long terme à de tels changements.
Analyser les influences du réchauffement planétaire sur l’exploitation
Toutes les régions de Suisse ne sont pas touchées de la même manière par le changement climatique. Les prévisions climatiques permettent d'évaluer les risques pour une région. Chaque branche de production encourant des risques différents, il convient d'identifier les problèmes et les opportunités potentielles afin d'élaborer suffisamment tôt une stratégie d'adaptation pour l'exploitation. Les conseillers et conseillères des branches peuvent être d'une grande aide dans ce contexte.
Élaborer des bases sur la disponibilité et la consommation de l’eau
En ce qui concerne la consommation d'eau dans l'agriculture, les données actuelles sont lacunaires. Ces données seraient importantes pour la détection précoce et la prévention des conflits liés à l'utilisation de l'eau. Le projet « Swiss Irrigation Info » (en allemand) s'occupe entre autres de la collecte de ces données. Des méthodes d'estimation basées sur des satellites et des modèles sont développées pour une gestion durable des ressources en eau.
L'élaboration de bases sur la disponibilité et la consommation de l’eau est essentielle. On peut s'attendre à ce que la consommation d'eau dans l'agriculture augmente. Parallèlement, les pénuries d'eau locales et temporaires sont déjà de plus en plus fréquentes. À l'avenir, la pénurie d'eau va encore s'accentuer, en particulier pendant les mois d'été (Hydro-CH2018).
L'Office fédéral de l'environnement a démontré, dans son projet « Grundlagen für die Wasserversorgung 2025 » (en allemand), que grâce à une planification anticipée et une utilisation raisonnée, l'eau restera disponible en quantité suffisante à l'avenir. L’essentiel est de répartir judicieusement l’eau disponible.
Utilisation raisonnée de l'eau
Outre dans l’arrosage, une utilisation parcimonieuse de l'eau est également importante sur l'exploitation agricole et au ménage. Les buses haute pression, par exemple, permettent un nettoyage efficace avec moins d'eau. Le nettoyage de l'installation de traite nécessite une quantité d'eau non négligeable, qui peut être recollectée et traitée. Les eaux usées ne peuvent cependant pas être réutilisées sans traitement (par exemple pour l'irrigation), car des normes de qualité strictes s'appliquent.
Prévisions climatiques par canton
Comme la Suisse dispose de topographies très diverses, les changements peuvent avoir des effets différents selon les régions. Pour des informations plus détaillées sur la situation actuelle et les prévisions, la Confédération propose un aperçu par grande région climatique et par canton :
Créer une capacité de stockage d'eau supplémentaire
Si une plus grande autonomie est souhaitée, il est possible d'investir dans des installations de récupération de l'eau des toits, qui sera stockée dans des réservoirs souterrains. Cette eau est de bonne qualité et peut être utilisée pour abreuver le bétail, pour le ménage (WC, machine à laver) ou même comme eau potable après traitement (aux UV par exemple). Ces systèmes sont toutefois coûteux et nécessitent de l'espace de stockage qui serait autrement utilisé pour l'exploitation du sol.
Exploitations de montagne et alpages
Dans les alpages, la disponibilité de l'eau pour le bétail, les habitations, les installations de traite et la transformation du lait, lorsque l'alpage fabrique le fromage sur place, s'ajoute au problème du fourrage. Dans le Jura notamment, l'eau manque régulièrement, ce qui oblige les personnes travaillant à l’alpage à acheminer de l’eau venant de loin ou à faire descendre une partie du bétail dans la vallée. L'approvisionnement en eau des alpages provient notamment de sources naturelles et de l'eau des toits collectée et stockée dans des citernes. Les étangs et les bassins sont d'autres possibilités de stockage. De telles constructions sont très coûteuses et peu rentables pour les alpages, qui ne sont exploités que quelques mois par an, mais les cantons et la Confédération peuvent participer aux coûts par le biais des contributions pour les améliorations structurelles. La qualité de l'eau peut elle aussi se dégrader, notamment en cas de sécheresse et de températures élevées.
Si en plus du fourrage, l’eau vient à manquer, la tradition séculaire de l’alpage pourrait être mise en péril. Il existe toutefois des solutions pour optimiser l’occupation par le bétail sur les pâturages. Parfois, ces derniers sont mal broutés, car le chemin jusqu'à l'eau est trop long pour le bétail. La répartition des points d'eau est donc d'une importance capitale pour que toutes les surfaces de pâturage soient utilisées au mieux.
Pour faire face à ces défis croissants, Agroscope a mis en place en 2022 une Station d’essais Agriculture de montagne et d’alpage, qui développe des solutions pratiques. Les grands projets portent sur une exploitation adaptée aux conditions locales dans le contexte du changement climatique, sur la technologie du lait et sur la gestion durable des alpages.
Gestion régionale des bassins versants
Pour les exploitations agricoles, le bassin versant de la région est d'une importance capitale. La responsabilité de la gestion régionale des ressources en eau incombe aux cantons. Pour éviter une pénurie d'eau au niveau régional, il faut planifier. Les sources d'eau utilisées pour alimenter les exploitations sont différentes d’une région à l’autre. C'est pourquoi l'influence du changement climatique varie aussi fortement de région en région.
Pour l'irrigation des cultures, les agriculteurs et agricultrices s'organisent de plus en plus en coopératives afin d'obtenir de l'eau d'irrigation. Dans les régions n'ayant pas accès aux ressources en eau de surface ou souterraine, le développement de réservoirs d'eau est encouragé. Les contributions aux améliorations structurelles soutiennent depuis 2003 des projets d'irrigation afin de garantir une utilisation durable de l'eau. Cette mesure a pour but d'augmenter la compétitivité du système alimentaire suisse.
L'agriculture n'est pas la seule actrice à avoir besoin d'eau. On estime que l'industrie représente 55 % des besoins, les ménages 25 % et l'agriculture les 20 % restants. Cependant, environ la moitié de l'eau comptabilisée pour l'agriculture s'écoule par les fontaines sans être utiliséeQ14. Il existe de nombreux conflits d'usage et la hiérarchisation des besoins devra tenir compte du rôle central du secteur agricole. Une approche globale est donc nécessaire pour concilier les besoins de l'industrie, des activités de loisirs, du tourisme et de tous les autres acteurs d'une région.