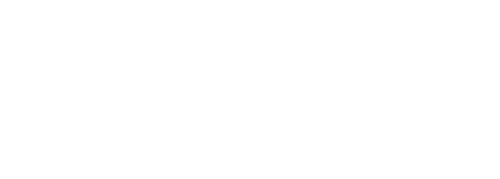Concrètement, ça veut dire quoi s’adapter ?
Cultures fourragères
Généralités
Le paysage agricole suisse repose en grande partie sur des prairies. C’est le cas dans plusieurs régions du Plateau, du Jura, de la zone des collines préalpines et des Alpes. Comme les bovins consomment principalement du fourrage de prairie, le changement climatique constitue un défi pour la production de fourrage. Il en résulte une pression sur l'alimentation de nos animaux de rente, mais aussi sur le système de l'économie alpestre, ce qui a des conséquences sur le tourisme et d'autres secteurs économiques qui, à première vue, n’ont pas l’air impactés. Bien sûr, une période de végétation plus longue pourrait permettre des rendements supplémentaires, mais à condition que le manque d'eau ne les réduise pas.
Plantes résilientes et résistantes
Les variétés de plantes fourragères sont plus ou moins sensibles à la sécheresse.
Contrairement à l'étranger, les agriculteurs et agricultrices suisses cultivent rarement des cultures fourragères pures ; il s'agit le plus souvent de mélanges de graminées, de trèfles et d’autres plantes. Une plus grande diversité d‘espèces dans les prairies contribue à rendre les plantes plus résistantes à la sécheresse. Les graminées vieillissent plus rapidement que les légumineuses et les autres planes, c'est pourquoi il est possible de retarder l'augmentation rapide des teneurs en fibres brutes en cas de sécheresse en augmentant la proportion d’autres plantes et de légumineuses. Les mélanges contiennent donc volontairement déjà différentes espèces, mais ces mélanges devront certainement encore être développés pour répondre au critère de tolérance à la sécheresse.
Pour les prairies, le choix du mélange fourrager est déterminant. Parmi les graminées, le dactyle et la fétuque résistent relativement bien à la sécheresse et font souvent partie des mélanges 300. Parmi les légumineuses, la luzerne, la « reine des plantes fourragères », est cultivée seule ou en mélange et supporte bien la sécheresse grâce à sa racine pivotante très profonde. Sur les prairies peu intensives, l’esparcette fait un retour en force et présente des caractéristiques intéressantes. Sur les prairies intensives, le trèfle violet est recommandé car, à rendement comparable, il est plus tolérant à la sécheresse que le ray-grass anglais et peut combler les vides en cas de disparition de graminées due à la sécheresse.
Le DryMountProject (2023-2027) d'Agroscope teste dans les cinq cantons partenaires de la station d'essais Agriculture de montagne et d'alpage de nouveaux mélanges fourragers mieux adaptés à la sécheresse dans les régions de montagne.
Hauteur et moment de la coupe
En cas de sécheresse et de températures élevées, il est d'autant plus important de prendre soin des plantes. En définitive, on a moins de possibilités de réagir : les engrais agissent moins bien sans humidité et les cultures ne se rétablissent que lentement, les sursemis ne sont possibles que de manière limitée. Une hauteur de coupe de 6 à 8 centimètres présente différents avantages pour la production de fourrage (en général et dans le contexte du changement climatique) :
- Faucher trop bas favorise les mauvaises graminées fourragères et évince les bonnes. Cette situation s'explique par le fait que les bonnes graminées fourragères ont tendance à stocker leurs réserves plus haut que les mauvaises. Avec une coupe trop basse, les bonnes graminées fourragères se rétablissent donc lentement, tandis que les mauvaises ont un avantage et peuvent s'étendre.
- La perte de rendement est relative. La culture s'améliore, croît plus rapidement, les teneurs en nutriments et en énergie augmentent (les parties inférieures des tiges contiennent peu de nutriments et d'énergie, elles ont tendance à être lignifiées).
- Les cultures courtes souffrent davantage de la sécheresse : le sol s'assèche davantage en raison de la végétation moins dense.
- Lors de la récolte, moins de saletés se retrouvent dans le fourrage, car la terre n’est pas grattée à des endroits irréguliers et les taupinières ne sont pas retournées.
- Pendant les périodes chaudes et sèches, il est judicieux de faucher un peu plus tard. Certes, la qualité du fourrage diminue quelque peu, mais la récolte serait un stress supplémentaire pour les plantesS23.
Gestion des pâturages et du cheptel
L'herbe ne pousse pas de manière uniforme tout au long de l'année. Les graminées fourragères sont très résilientes. Elles font une pause dans leur croissance lorsque l'eau se fait rare et font preuve d'une étonnante capacité de reprise après la pluie. C'est pourquoi il y a généralement une première poussée de croissance au printemps à partir de l'humidité stockée dans le sol pendant l'hiver. En été, la croissance diminue et atteint un deuxième pic à la fin de la saison, en automne. Il est donc recommandé de commencer à pâturer tôt au printemps, avec un nombre relativement élevé d'animaux par unité de surface et avec des pâturages tournantsS24. En été, lorsque la pousse de l'herbe diminue, il faut adapter la charge de bétail, notamment en cas de sécheresse, en augmentant la surface de la parcelle de pâturage ou en diminuant le nombre d'animaux (estivage, séparation des vaches taries et des jeunes vaches, etc.)S25. En automne, on peut à nouveau augmenter l’occupation conformément au cycle de croissance de l'herbe. À ce moment-là, il peut aussi être intéressant de procéder à un sursemis, qui, avec l'humidité hivernale, a de meilleures chances de démarrer qu'un semis de printemps.
Les zones d'estivage sont une source de fourrage supplémentaire très importante qu'il convient de mieux exploiter. Après la montée à l'alpage, le nombre de bêtes reste généralement stable tout au long de l'été, car la montée représente beaucoup de travail et le transport du bétail n'est pas chose facile. Cependant, en cas de sécheresse, l'herbe des pâturages peut ne pas suffire à nourrir tout le troupeau. C'est pourquoi il est parfois nécessaire d'apporter des aliments de la vallée.
Le type de bétail et les races sont également importants et il se peut qu'une modification du cheptel soit nécessaire à long terme. Les races indigènes, par exemple, sont plus résistantes, y compris au changement climatique, et sont moins exigeantes en matière d'alimentation.
Capacités de stockage de fourrage et solutions alternatives
La hausse des températures, la sécheresse et les évènements extrêmes réduisent la stabilité des rendements et la qualité. La production de fourrage grossier de la ferme devient donc de moins en moins fiable et il peut être judicieux de constituer des stocks plus importants. Il en résulte des transformations ou des extensions, et donc des frais d’investissement. Comment peut-on rester flexible lorsqu’on produit du fourrage ?
- Adapter la production de fourrage aux conditions locales
- Se diversifier : utiliser les effets de la rotation des cultures (nutriments) et répartir les risques
- Pratiquer des cultures intermédiaires
- Tester de nouvelles cultures
- Adapter le moment et la fréquence de la coupe
- Limiter les pertes dans les champs, à la récolte, au stockage et à la mangeoire
- Établir un contrôle de gestion : saisie des rendements, surveillance des silos, surveillance des quantités de fourrage, etc.
- Prévoir à tout moment au moins 20 % de réserve ou des stocks pour 2-3 mois
- Produire du fourrage de manière flexible : ajuster la planification des cultures et des fourrages aux réserves et aux perspectives de récolte, pratiquer des cultures intermédiaires, ensiler des plantes entières, etc.
- Si la pluie s'annonce, envisager de semer une culture intermédiaire pour compenser une partie du manque à gagner estival
- Réguler rapidement les adventices tenaces afin qu'elles ne puissent pas se propager, réensemencer les trous dans la couche herbeuse : l’entretien des prairies est important !
- Ajuster la production laitière (génétique, race) pour que les animaux soient plus flexibles
- Gérer le fourrage au niveau régional ou entre les exploitations
- Ajuster le nombre d’animaux (en fonction des prix)
- Se tourner vers des bourses fiables de fourragesS27
- Cultiver du sorgho, une céréale ressemblant au maïs, originaire d'Afrique, particulièrement bien adaptée à la sécheresse. Le sorgho appartient à la famille des graminées et peut être fauché, ensilé ou pâturé. En cas d'utilisation en guise de fourrage, le bétail risque d'être intoxiqué par l'acide cyanhydrique s'il consomme de jeunes plantes. Bütikofer N. et al. (2023) fournissent une carte pour la production de sorgho qui tient compte de ses besoins en chaleurS26 (voir aussi Mesures d'apations - Grandes Cultures).
Agroforesterie et biodiversité
Les cultures mixtes typiques en Suisse, telles que les arbres à haute tige dans les prairies ou les pâturages, sont comprises dans l’agroforesterie. Dans le cadre du changement climatique, ce système fait l'objet d'un regain d'attention, car il contribue à une adaptation efficace à des conditions plus chaudes et plus sèches et utilise plus efficacement les nutriments, l'eau et la lumière. Les arbres offrent de l'ombre aux animaux de rente et réduisent ainsi localement les températures. Leur système racinaire profond est en outre capable de faire remonter les ressources en eau des couches profondes de la terre, ce dont profite également l'herbe. Cette propriété permet aussi d’augmenter la formation d’humus, améliorant la capacité de rétention des sols et rendant ceux-ci plus résistants à la sécheresse.
En outre, les arbres et les arbustes fournissent un habitat et de la nourriture ax insectes et aux petits animaux, favorisant ainsi la biodiversité.
La promotion de la biodiversité fait partie des prestations écologiques requises, dont le respect conditionne à son tour l'obtention de paiements directs. Les exploitations doivent réserver 7 % de leur surface agricole utile à la promotion de la biodiversité. Le fait que la moyenne de SPB de toutes les exploitations est de 19 % montre que la préservation et la promotion de la biodiversité est une préoccupation des familles paysannes suisses.
Les éléments de biodiversité sont très nombreux sur les prairies : pâturages et prairies structurés extensifs ou peu intensifs, haies, arbres isolés, pâturages boisés ou forestiers, surfaces en zone d'estivage, mais aussi murs de pierres sèches ou fossés, mares et étangs. La promotion de la biodiversité contribue à des écosystèmes plus stables et a un impact positif à moyen et long terme sur la teneur en humus, ainsi que sur la capacité de rétention d'eau et la fertilité des sols.
En apprendre plus au sujet de la biodiversité : Zoom numérique «Biodiversité»
Santé des sols
Si l'importance de la santé des sols semble plus évidente dans les grandes cultures, elle ne doit pas être négligée dans les cultures fourragères. De courtes fenêtres de beau temps et de longues périodes de pluie ont pour conséquence que les cultures fourragères doivent parfois être récoltées à des moments défavorables. Cette récolte peu propice entraîne un tassement du sol et un fourrage souillé.
Les prairies permanentes sont constamment recouvertes de plantes, ce qui limite au maximum l'érosion et les pertes de nutriments. Il s’agit plutôt de prendre soin de la couche herbeuse, de réensemencer les éventuels trous afin d'éviter que des adventices tenaces ne s'y installent.
La sécheresse estivale croissante rend plus difficile un nouvel ensemencement des prairies après la récolte des céréales. Dans ce cas, il vaut la peine de réfléchir à des sous-semis dans la culture précédente afin de profiter de l'humidité du sol et de permettre à l’herbe de prendre un bon départ. Les sursemis permettent d'améliorer la qualité des plantes sans qu'il soit nécessaire de ressemer toute la parcelle.
Alors que les sols sous les prairies permanentes sont généralement bien aérés et ont une bonne capacité de rétention d'eau, les défis posés par les cultures fourragères artificielles en matière de fertilité des sols sont similaires à ceux des grandes cultures (Santé des sols dans les grandes cultures).
Irrigation et stockage de l'eau
Alors que l'irrigation devient un sujet de plus en plus important dans les grandes cultures, elle n'est pas rentable dans les cultures fourragères, même dans les scénarios extrêmesS13. Il existe certes des systèmes traditionnels d'irrigation des prairies, par exemple en Valais (lesdites bisses). Il n’est ainsi pas prévu que les prairies soient irriguées au cours des prochaines décennies. Le stockage de l'eau concerne donc avant tout l'élevage.
Vous trouverez plus d'informations sur les aspects importants liés à l'eau, tels que les conflits d'utilisation, les coûts d'investissement et l'irrigation, dans le chapitre « Grandes cultures - Irrigation et stockage de l'eau ».
Plantes envahissantes
En Suisse, les insectes, les adventices, les néophytes et les maladies ont tendance à faire partie des gagnants du réchauffement climatique, car des températures plus chaudes pendant les mois d'été, des périodes de végétation plus longues et des hivers plus doux favorisent leur développement et créent de meilleures possibilités de propagation. Par ailleurs, de nouveaux ravageurs originaires de contrées plus chaudes émigrent déjà en Suisse, menaçant les cultures indigènes.
Le problème est nettement plus important dans les grandes cultures et les cultures spéciales que dans les cultures fourragères. Cependant, ce sont justement les plantes invasives qui profitent des conditions plus douces et qui colonisent des régions de plus en plus en altitude, jusqu'alors épargnées. L'une d'entre elles est le séneçon de Jacob (ou séneçon jacobée). Cette plante toxique se répand dans les pâturages et peut entraîner la mort d’un animal de rente si elle est consommée. Les jeunes animaux sont avant tout concernés, les animaux plus âgés évitant généralement la plante dans les pâturages. Néanmoins, si l'herbe se retrouve dans le foin ou l'ensilage, les animaux ne peuvent plus la distinguer des autres aliments.