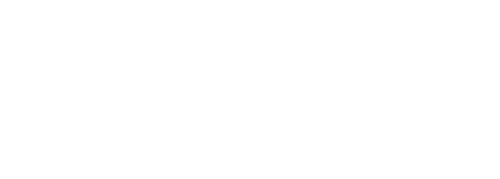En visite chez Frédéric Zosso
« La cohérence écologique totale est une mission impossible »
Il produit du courant écologique et utilise, à cet effet, surtout le lisier et le fumier de ses propres animaux. Pour ne pas être dépendant de matières premières très éloignées, il a construit « juste » une petite installation de biogaz. Un entretien avec Frédéric Zosso, agriculteur, sur le changement climatique, sa contribution pour la réduction des émissions de CO2 et les contradictions inhérentes à ces objectifs.
- 90 ha de surface agricole
- 45 ha de grandes cultures (18 ha de blé panifiable, 4 ha de colza, 1 ha d'épeautre, 1 ha d’amidonnier, 1ha de seigle, 2 ha de lentilles, 5 ha de maïs grain, 3 ha de céréales fourragères, 5 ha de betterave sucrière et 5 ha de soja)
- 70 vaches laitières et 60 têtes de jeune bétail (prévues dans une nouvelle étable après un incendie en 2023)
- 1 grand jardin de maraîchage
- 4000 poules pondeuses
- Personnel sur la ferme : Le couple exploitant, le père, un employé, deux apprentis
Frédéric Zosso, originaire de Cournillens dans le canton de Fribourg, est un agriculteur très actif. Il est ouvert aux nouveautés et en permanence à la recherche d’améliorations. Le marché peu satisfaisant et l’envie de relever de nouveaux défis l’ont poussé, en 2015, à se convertir à la production biologique. Avec une exploitation de 90 hectares dont 45 hectares de grandes cultures, cette étape fut pour lui déterminante. Cet agriculteur infatigable tire son énergie de ses convictions profondes qui le poussent sans cesse à se remettre en question et se réinventer. Ce qui le motive avant tout, c’est la notion de durabilité et ses trois piliers, écologiques, économiques, mais aussi sociaux.
Dès 2013, il a mis en route une petite installation de biogaz sur son exploitation et équipé la partie du toit de l’étable orientée vers le sud de panneaux solaires sur une surface de 2000 m2. Il utilise la récupération de chaleur de l’installation de biogaz pour sécher le foin, d’autres cultures fourragères, les grains de maïs, les céréales, les lentilles, le colza ou le bois.
Seulement, l’année dernière, un terrible incendie ravage entièrement son étable qui pouvait accueillir quelques 130 têtes de bétail (vaches laitières et jeunes bovins). Malgré ce coup du sort, l’exploitant ne se laisse pas abattre et planifie actuellement une nouvelle étable avec une capacité similaire, entièrement recouverte de panneaux solaires. Cette production d’électricité verte lui permet d’envisager un nouveau bâtiment largement robotisé (traite et raclage du lisier). Mais au lieu de compter sur la technologie pour réguler la température de sa future étable, il mise sur une aération naturelle qui combine un bâtiment très ouvert et orienté sur sa colline bien ventilée pour maximiser les courants d’air. Il espère ainsi offrir un climat agréable à ses animaux, convaincu de la place des vaches dans l’équilibre de son exploitation.
« Transporter les matières premières sur de longues distances est une absurdité écologique »
Le lisier et le fumier de ses bêtes ajoutés au fumier de volaille et de cheval de deux voisins lui servent de matière première pour son installation de biogaz. Sa décision d’exploiter aujourd’hui une installation relativement modeste vient de son refus de transporter les matières premières sur de longues distances pour ne pas nuire à l’environnement. Des personnes comme lui, on n’en trouve pas beaucoup en Suisse. « L’installation fonctionne jour et nuit et est donc soumise à une forte usure. Les dérangements, grands ou petits, sont relativement fréquents. Parfois, j’ai juste envie d’enfouir tout cela dans un immense trou et de ne plus y penser », soupire-t-il de manière théâtrale, tout en faisant un clin d'œil. Le lisier obtenu après fermentation est déversé dans une installation séparée. Il récupère ainsi une solution aqueuse riche en nutriments et aussi une sorte de compost. Ces deux substances constituent un engrais naturel très riche et sans odeur pour ses cultures.
Tributaire de la météo et affecté par le changement climatique
Frédéric se pose des questions sur le changement climatique. Il trouve que les conditions météorologiques deviennent plus extrêmes en Suisse. Il y a aujourd’hui bien plus souvent de très longues phases de sécheresse ou d’humidité extrêmes. En 2018, 2020 et 2022, il a souffert, lui aussi, de l’absence de pluie. C’est surtout sa récolte fourragère qui a été affectée. Comme il n’a pas pu se résoudre à vendre ses bêtes, il a dû acheter du fourrage en plus. « En fait, j’ai été surpris que les grandes cultures aient si bien supportées la sécheresse ». Il impute cela à un sol profond et riche en humus dont il prend grand soin. Notamment par le biais de la culture de couverture en hiver ou d'un travail du sol respectueux (par exemple, le semis direct), ainsi que par la rotation des cultures. Les deux dernières méthodes retirent du CO2 de l'atmosphère grâce à la formation de humus.
Conscient du défi que représente la production d’un fourrage de qualité en quantité suffisante, Frédéric Zosso a repensé l’alimentation de ses bovins et a planifié de doubler sa capacité de stockage dans son nouveau bâtiment. Selon ses calculs, une alimentation en foin et fourrages secs en plus du pâturage réduirait ou du moins ne péjorerait pas son empreinte carbone. Il compte ainsi optimiser le stade de la fauche pour garantir une bonne qualité du fourrage ainsi qu’une bonne repousse de l’herbe, tout en évitant les aller-retours quotidiens avec son tracteur, sa faucheuse et l’auto-chargeuse pour l’affouragement en herbe fraîche.
Espérance dans les nouvelles technologies
Et où voit-il des possibilités pour réduire ses émissions ? « Il y a beaucoup de petites marges de progression. Personnellement, je place beaucoup d’espoir dans les nouvelles technologies, par ex. quand de petits robots autonomes seront capables de désherber les champs. » Car, depuis le passage à la production biologique, il procède à un désherbage mécanique régulier, ce qui a fait augmenter sa consommation de carburant et donc ses émissions de CO2. Ce genre de « contradiction » au niveau pratique est fréquent dans l’agriculture quand on poursuit des objectifs au niveau de l’orientation générale. Vouloir être absolument parfait relève vraiment de la gageure.
Nourrir localement
En 2023, lassé par les conditions d’achat de la coopérative qu’il fournissait en pommes de terre et en carottes (exigences dans la qualité et les variabilités de prix interannuelles liées à l’offre et à la demande), il décide d’abandonner ces cultures peu valorisantes au profit par exemple d’anciennes variétés de céréales, du colza, des lentilles ainsi que sa petite production maraîchère pour étayer l’offre de son magasin à la ferme et à la vente directe.
Il constate ainsi que ses quelques 70 clients hebdomadaires sont davantage tolérants et se montrent compréhensifs non seulement sur l’esthétique et le calibre, mais également en ce qui concerne les petites imperfections, par exemple des petits trous de ravageurs. Les retours très positifs de ses clients l’encouragent à continuer dans cette voie qui lui procure davantage de satisfaction, malgré une charge en travail plus élevée. Sa vision reste de fournir aux gens qui vivent à proximité de sa ferme des aliments bio et sains, produits de manière durable.