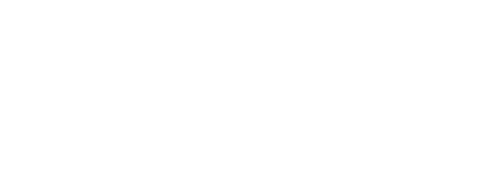Création de valeur
La valeur de production de l’agriculture suisse se compose de la création de valeur dans les différents secteurs. La figure 2 montre comment les valeurs des produits d’origine végétale et animale ont évolué. La production végétale contribue pour environ un tiers à la valeur de production de l’agriculture, les cultures spéciales telles que les légumes, les fruits, les baies et la viticulture ainsi que les plantes fourragères jouant un rôle dominant en valeur. Elles représentent au total environ deux tiers de la valeur de production végétale. Le tiers restant est constitué, par ordre décroissant, des céréales, de loin les cultures arables les plus répandues en surface, suivies des pommes de terre, des betteraves sucrières, des oléagineux et des protéagineux. La valeur de la production végétale est soumise à de fortes variations annuelles. Celles-ci sont principalement dues aux conditions météorologiques : les longues périodes sèches ou humides, la grêle ou les gelées tardives ont des conséquences directes sur les rendements ou la qualité et donc sur la valeur de la production. Le manque de possibilités de protection contre les maladies et les ravageurs se fait également de plus en plus sentir.
Évolution de la valeur de la production
Figure 2 : évolution de la valeur de la production en millions de francs
Orientation vers le marché
Les exploitations agricoles orientent leur production en fonction des besoins et demandes actuels du marché. Les risques liés aux cultures, les fluctuations des rendements, les variations de la demande en fonction des conditions météorologiques, les tendances en matière de consommation ou encore les variations saisonnières rendent la planification difficile. La demande croissante en protéagineux est un exemple. En théorie, les agriculteurs et agricultrices pourraient en profiter. En pratique, les défis sont considérables :
- Les conditions météorologiques, les ravageurs et les maladies entraînent de fortes variations de rendement.
- Il manque une protection douanière qui abrite la production indigène des importations bon marché. De ce fait, les protéagineux suisses affichent des prix beaucoup plus élevés que les produits importés et sont moins compétitifs en comparaison.
- La capacité de transformation des protéagineux en Suisse est limitée.
- Il manque un engagement clair des grands transformateurs de protéines végétales et du commerce de détail en faveur des matières premières suisses.
- Il manque des prix indicatifs contraignants et des conditions de prise en charge qui permettent une culture rentable.
Les labels et leur influence sur la création de valeur
Les labels tels que « IP-SUISSE » et « Bio Suisse » ou l’indication de provenance « Suisse Garantie » jouent un rôle important dans la demande en produits végétaux. Les deux labels garantissent aux consommateurs des méthodes de culture durables. « Suisse Garantie » est synonyme d’origine suisse contrôlée et garantit que les produits sont fabriqués en Suisse à partir de matières premières suisses. De telles certifications soulignent la valeur ajoutée de la culture et l’origine locale sur le marché. Dans l’idéal, les agriculteurs et agricultrices profitent ainsi de prix plus élevés, car les consommateurs et consommatrices sont prêts à payer plus pour des produits certifiés. Des prix plus élevés ainsi que d’éventuelles primes doivent également couvrir les pertes liées à la baisse de rendement.
Cependant, il y a aussi des limites à ce système : si la demande n’augmente pas dans les mêmes proportions, une offre excédentaire de produits certifiés peut entraîner une chute des prix ou une baisse des primes pour les producteurs. De plus, les exigences de ces certifications sont souvent associées à des coûts plus élevés.